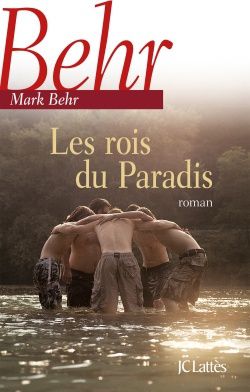« Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons en glaise et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des oeufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village et, dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins, faisait part des nouvelles inventions ».
Cela faisait bien longtemps que j’avais l’intention de lire Gabriel Garcia Marquez et en particulier Cent ans de solitude… mais vous savez ce que c’est… des envies de lecture, on en a plein, plein… et on ne peut pas tout lire d’un coup… et puis voilà que cet immense écrivain meurt… et là je me dis, c’est « l’occasion », il te faut le lire… et dès le lendemain de son décès, une amie me prête Cent ans de solitude… les dés en étaient jetés, j’étais partie dans la belle aventure de la découverte et de la lecture plaisir de ce très beau roman qui nous raconte la destinée incroyable de la famille Buendia et de la fondation et du déclin du village de Macondo. Dès les premiers mots, j’ai ressenti la même sensation que j’avais eu en lisant, il y a déjà bien longtemps, pour la première fois Isabel Allende et sa maison aux esprits… une belle claque ! Une claque positive…. une entrée dans une écriture différente, une mentalité, une façon de voir la vie, différentes…. là le merveilleux ou plutôt l’imaginaire côtoie la réalité, sans aucune frontière, pareil pour les morts et les vivants…. les morts reviennent discuter tout naturellement avec les vivants… les personnages de cette famille sont très particuliers, vivent très longtemps, surtout pour certains, certaines comme l’un des piliers de cette famille et de ce roman, Ursula, la mère, grand-mère, arrière grand-mère etc. Tous les personnages se mêlent et s’entremêlent… beaucoup se « mariant » en famille, avec une tante, une demi-sœur, une cousine… sans savoir toujours qui est qui…. les prénoms également se mélangent et changent peu…. on mixe allégrement, Aureliano, José Arcadio, Amarantha, Ursula, etc.
Ce roman « raconte » aussi au travers la famille Buendia l’Histoire et les légendes de ce pays… bien sûr pas chronologiquement, pas de manière purement historique, mais en « décalé », imagé… perso je ne connais pas assez, pour avoir tout reconnu, mais je sais, pour l’avoir lu qu’un très bel épisode dramatique du livre qui relate le massacre de plus de 3.000 personnes, des travailleurs en grève de l’industrie bananière et de leurs familles, et surtout aussi le silence et le déni de la version officielle, fait allusion à un épisode réel…. Je me permets de mettre ici un extrait de l’article « DÉCÈS DE GARCÍA MÁRQUEZ Relire "Cent ans de solitude" » écrit par l'écrivain colombien Juan Gabriel Vásquez paru dans le journal Le courrier international. http://www.courrierinternational.com/article/2014/04/18/relire-cent-ans-de-solitude?page=all
« L’un de ces romans est bien entendu Cent Ans de solitude. Et pour illustrer, ne serait-ce que sommairement, la belle insolence avec laquelle ce type de roman affronte le monstre de l’Histoire, il n’y a pas de meilleur épisode de l’histoire colombienne que le massacre des plantations bananières, survenu le 6 décembre 1928. Peut-être connaissez-vous dans les grandes lignes ce qui s’est passé ce jour-là : la United Fruit Company, entreprise américaine qui exploitait depuis le début du XXe siècle les plantations de bananes de la côte Caraïbe, le faisait dans un mépris total du droit du travail colombien, et à maintes reprises ses milliers de salariés avaient menacé de faire grève. Le 5 décembre, la rumeur court parmi les travailleurs que le gouverneur du département du Magdalena se rendra au village le lendemain pour entendre leurs doléances.
Une foule anxieuse se rassemble à la gare et refuse de se disperser malgré la décision du chef militaire de la province, le général Cortés Vargas, qui a interdit tout rassemblement de plus de trois personnes, annonçant qu’il n’hésiterait pas à faire tirer sur la foule si nécessaire. Les militaires donnent aux ouvriers cinq minutes pour se disperser, après quoi ils se mettent à tirer au hasard. Le général Cortés Vargas reconnaîtra les faits, les justifiera au nom du maintien de l’ordre public et déplorera la mort de neuf manifestants. Peu après, l’ambassadeur des Etats-Unis parlera de cent morts, puis de cinq cents ou six cents, et, dans un rapport remis au département d’Etat, il finit par parler de plus de mille. On n’a jamais su le chiffre exact, mais les faits de cette journée, et surtout l’impossibilité de confirmer la vérité historique, sont restés gravés dans la mémoire culturelle colombienne. Le caricaturiste Ricardo Rendón les a immortalisés dans la presse nationale, un grand romancier, Alvaro Cepeda Samudio, leur a consacré un roman entier, La Casa grande, puis García Márquez les a explorés dans l’un des meilleurs chapitres de Cent Ans de solitude ».
Voilà… je trouve qu’il était important de souligner, que ce roman va bien au-delà du « simple » merveilleux…
Bref, ce gros livre m’a paru encore trop rapide tellement j’ai pris plaisir à le lire, …. Alors si vous ne l’avez pas encore lu, n’attendez plus !
« On n'est de nulle part tant qu'on n'a pas un mort dessous la terre ».
Résumé éditeur :
Cent Ans de solitude. Epopée de la fondation, de la grandeur et de la décadence du village de Macondo, et de sa plus illustre famille de pionniers, aux prises avec l'histoire cruelle et dérisoire d'une de ces républiques latino-américaines tellement invraisemblables qu'elles nous paraissent encore en marge de l'Histoire. Cent Ans de solitude est ce théâtre géant où les mythes engendrent les hommes qui à leur tour engendrent les mythes, comme chez Homère, Cervantes ou Rabelais. Chronique universelle d'un microcosme isolé du reste du monde -avec sa fabuleuse genèse, l'histoire de sa dynastie, ses fléaux et ses guerres, ses constructions et ses destructions, son apocalypse- "boucle de temps" refermée dans un livre où l'auteur et le dernier de sa lignée de personnages apparaissent indissolublement complices, à cause de "faits réels auxquels personne ne croit plus mais qui avaient si bien affecté leur vie qu'ils se trouvaient tous deux, à la dérive, sur le ressac d'un monde révolu dont ne subsistait que la nostalgie".
« On ne meurt pas quand on veut, mais seulement quand on peut ».
Lien vers la fiche du livre sur Babélio :
http://www.babelio.com/livres/Garcia-Marquez-Cent-ans-de-Solitude/3779
« Le colonel Aureliano Buendia fut à l'origine de trente-deux soulèvements armés et autant de fois vaincu. De dix-sept femmes différentes, il eut dix-sept enfants mâles qui furent exterminés l'un après l'autre dans la même nuit, alors que l'aîné n'avait pas trente-cinq ans. Il échappa à soixante-trois embuscades et à un peloton d'exécution. Il survécut à une dose massive de strychnine versée dans son café. Il fut promu au commandement des forces révolutionnaires, son autorité s'étendant sur tout le pays.
Bien qu'il se battît toujours à la tête de ses troupes, la seule blessure qu'il reçu, ce fut lui qui se la fit. Il se lâcha un coup de pistolet en pleine poitrine et le projectile lui ressortit par l'épaule sans avoir atteint aucun centre vital.
Tout ce qui demeura de cette succession d'événements fut une rue à son nom à Macondo ».
« Taciturne, silencieux, insensible au nouveau souffle de vie qui faisait trembler la maison, c'est à peine si le colonel Aureliano Buendia comprit que le secret d'un bonne vieillesse n'était rien d'autre que la conclusion d'un pacte honorable avec la solitude ».
« Dans la longue histoire de la famille, la répétition persistante des prénoms lui avait permis de tirer des conclusions qui lui paraissaient décisives. Alors que les Aureliano étaient renfermés, mais perspicaces, les José Arcadio étaient impulsifs et entreprenants, mais marqués d'un signe tragique ».
« « Ils sont tous comme ça, dit-elle sans paraître surprise. Tous sont fous de naissance ». Le temps finit par tout emmêler. Celui qui, après leur imbroglio, était resté avec le prénom d’Aureliano le Second devint aussi colossal que son grand-père et celui auquel finit par échoir le prénom de José Arcadio le Second, aussi maigre et osseux que le colonel, et le seul trait commun qu’ils conservèrent fut cet air de solitude qu’ils tenaient de famille. Ce fut sans doute cette interversion des noms, des caractères et des constitutions physiques qui amena Ursula à suspecter que l’erreur qui avait brouillé les cartes remontait à leur enfance ».

Gabriel Garcia Marquez
« Dès que José Arcadio eut refermé la porte de la chambre à coucher, un coup de pistolet retentit entre les murs de la maison. Un filet de sang passa sous la porte, traversa la salle commune, sortit dans la rue, prit le plus court chemin parmi les différents trottoirs, descendit des escaliers et remonta des parapets, longea la rue aux Turcs, prit un tournant à droite, puis un autre à gauche, tourna à angle droit devant la maison des Buendia, passa sous la porte close, traversa le salon en rasant les murs pour ne pas tacher les tapis, poursuivit sa route par l’autre salle, décrivit une large courbe pour éviter la table de la salle à manger, entra sous la véranda aux bégonias et passa sans être vu sous la chaise d’Amaranta qui donnait une leçon d’arithmétique à Aureliano José, s’introduisit dans la réserve à grains et déboucha dans la cuisine où Ursula s’apprêtait à casser trois douzaines d’œufs pour le pain ».
« Il plut pendant quatre ans onze mois et deux jours. Il y eut des époques où il ne fit que pleuvoter et tout le monde se mît sur son trente et un, se composa une mine de convalescent pour célébrer l'éclaircie, mais bientôt l'habitude fut prise de ne voir dans ces pauses que les signes d'une recrudescence ».
« L'atmosphère était si humide que les poissons auraient pu entrer par les portes et sortir par les fenêtres, naviguant dans les airs d'une pièce à l'autre ».
« Ils sont tous les mêmes, se lamentait Ursula. Au début, on n'a aucun mal à les élever, ils sont obéissants et sérieux, paraissent incapables de tuer une mouche, et à peine la barbe leur pousse-t-elle qu'ils se jettent dans la perdition ».
« - « Plaquez-vous au sol ! Plaquez-vous au sol ! »
Déjà les premières lignes l’avaient fait, balayées par les rafales de mitraille. Les survivants, au lieu de se plaquer au sol, voulurent revenir sur la petite place et c’est alors que la panique, comme un coup de queue de dragon, les envoya rouler en grosses vagues serrées contre la houle compacte qui venait en sens inverse, refoulée par un coup de queue de dragon de la rue opposée où d’autres mitrailleuses tiraient également sans relâche. Ils étaient coincés dans cet enclos, pris dans un tourbillon gigantesque qui fut peu à peu réduit à son épicentre dans la mesure où la frange circulaire se trouvait systématiquement découpée, comme on pèle un oignon, par les cisailles insatiables et bien réglées de la mitraille ».
« Il n'y avait, dans le cœur d'un Buendia, nul mystère qu'elle ne pût pénétrer, dans la mesure où un siècle de cartes et d'expérience lui avait appris que l'histoire de la famille n'était qu'un engrenage d'inévitables répétitions, une roue tournante qui aurait continué à faire des tours jusqu'à l'éternité, n'eût été l'usure progressive et irrémédiable de son axe ».